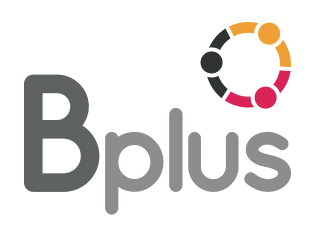Dans une opinion publiée dans De Morgen le 26 juillet dernier, Mark Elchardus se livre à un exercice désormais fort à la mode : la critique de l’État droit, cette fois caricaturé par le néologisme de « juristocratie ». Que le concept d’État de droit soit de plus en plus souvent remis en cause, y compris par des intellectuels supposés sérieux, ne peut qu’inquiéter sur l’évolution du discours et des mœurs politiques. Ce n’est malheureusement pas la première fois que B Plus doit le rappeler.

La loi et son interprétation
Le droit est affaire d’interprétation. C’est ce que tout étudiant en droit apprend dès sa première année d’université. Bien sûr, l’interprétation comprend par essence une part de subjectivité. Les juges ne font pas exception à cette règle, quand bien même ils font tout ce qu’ils peuvent pour faire abstraction de leurs sensibilités personnelles dans l’exercice de leur fonction. C’est pour pour cela que le droit prévoit différentes mesures pour éliminer autant que possible cette subjectivité : délibération collégiale et double degré de juridiction en sont des exemples. Force est cependant de constater qu’au cours du temps, le législateur – donc le politique – a largement amenuisé ces garde-fous, par exemple en généralisant la pratique des chambres à juge unique et en réduisant les possibilités d’appel, tout cela au nom de la rationalisation, des économies et d’une soi-disant meilleure administration de la justice (sic!). Sans compter que le manque de magistrats, qui contraint ceux-ci à examiner les dossiers de manière de plus en plus superficielle, ne contribue pas non plus à la qualité de l’interprétation de la loi et de son applications aux cas d’espèce.
Gouvernement des juges ou abdication du politique ?
Comme le relève M. Elchardus, l’État de droit, ce n’est pas « un projet idéologique de juges qui décident de la législation et de la politique via l'interprétation de vagues textes, concepts et principes, d'une manière qui n'a plus rien à voir avec les intentions du législateur et du constituant ». C’est précisément là qu’est le problème : lorsque les textes, les concepts et les principes sont vagues, cela ne fait qu’ouvrir grand la porte à la subjectivité des juges. Mais ce ne sont pas les juges qui sont responsables de l’imprécision des textes qu’ils doivent interpréter. Il existe depuis des années une tendance chez les responsables politiques à adopter des textes vagues dans le seul but de ne pas assumer des concessions politiquement difficiles. Plutôt que de devoir assumer une décision politiquement difficile, on préfère un compromis vague, et on se décharge ainsi de sa responsabilité sur le pouvoir judiciaire. Le cynisme est à son comble lorsque, après avoir ainsi refusé de prendre ses responsabilités de législateur, le politique reproche ensuite aux juges de ne pas interpréter comme il l’aurait voulu un texte imprécis et parfois simplement illisible.
Si, comme le prétend M. Elchardus, notre État de droit est devenu une « juristocratie », ce n’est pas aux juristes qu’il faut jeter la pierre : c’est aux politiques qui, depuis trop longtemps, fuient leurs responsabilités. Pour travailler correctement, les juges ont besoin de bon matériel, c’est à dire de lois claires, dont le texte ne laisse pas de place à l’ambiguïté.
Frustration
La critique de la « juristocratie » est surtout l’expression de la frustration de responsables politiques qui se rendent compte que la démocratie, ce n’est pas faire tout ce que l’on veut au motif que l’on est élu. Même pour un élu, il y a des règles à respecter. Et ces règles ont été fixées par le pouvoir politique lui-même. Au lieu de se plaindre que les limites que le droit fixe à leur pouvoir les empêchent de tenir leurs promesses électorales, les responsables politiques feraient mieux d’y réfléchir avant les élections et de ne pas promettre des choses qu’ils n’auront pas le pouvoir de réaliser.
La démocratie, ce n’est pas la toute-puissance de l’élu : c’est l’action de gouvernants agissant dans le respect du cadre constitutionnel qui a permis leur élection. La démocratie, ce n’est pas non plus la force brutale du nombre : c’est le respect par la majorité des règles qui bornent son pouvoir et qui ont été décidées de manière politique.
Les responsabilités à leur place
Depuis plusieurs années, on constate la multiplication des attaques contre l’État de droit et la séparation des pouvoirs. Jusqu’ici, ces attaques venaient le plus souvent de responsables politiques frustrés de voir que le droit – et ses gardiens que sont les cours et tribunaux – pose des bornes à leur action. Si B Plus a toujours condamné ces attaques, celles-ci pouvaient encore se comprendre dans le chef de personnes plongées dans l’action. Que des intellectuels, non mandataires politiques, décident d’entonner le même refrain sans le moindre recul critique ne peut que nous inquiéter encore plus. Dans ces temps où s’affirme de plus en plus la loi brutale du plus fort, il est essentiel de garder son esprit critique en éveil et de se souvenir des responsabilités de chacun. La responsabilité des juges est d’interpréter la loi dans le respect de son esprit. La responsabilité du politique est d’adopter des lois claires et de ne pas promettre n’importe quoi aux électeurs.